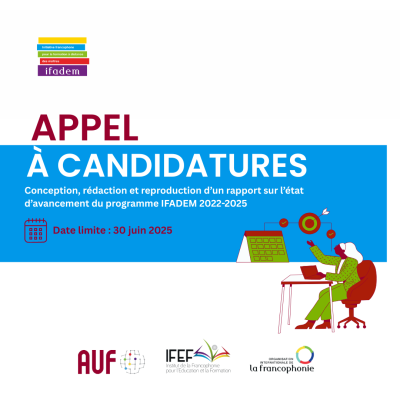Haïti
L’enseignement fondamental accueille les enfants de 6 à 14 ans. Il dure 9 années et il est constitué de 3 cycles : le premier de 4 ans, le deuxième de 2 ans et le troisième de 3 ans.
Le système éducatif haïtien est divisé en 2 sous-secteurs :
- formel
- non formel.
Le secteur formel comprend les 4 niveaux d’enseignements
- l’éducation préscolaire;
- l’enseignement fondamental
- l’enseignement secondaire
- l’enseignement supérieur.
Le secteur non formel concerne
- l’alphabétisation
- la post-alphabétisationdes adultes âgés de 15 ans et plus.
L’actuel plan sectoriel couvre la période 2013-2016 vise à promouvoir le développement de l’éducation de la petite enfance et de l’enseignement préscolaire, ainsi que l’alphabétisation des enfants et des adultes.
Il se concentre donc sur l’enseignement fondamental afin d’améliorer les compétences de base des élèves en permettant notamment l’accès et la qualité dans l’enseignement primaire, ainsi que l’accès et l’achèvement du premier cycle de l’enseignement secondaire
Indicateurs
- Nombre total d’élèves au cycle primaire : 1 485 722 dont 49% filles
- Ratio d’encadrement élèves/enseignant : 33
- Taux brut de scolarisation : 114 %
- Taux d’alphabétisme des jeunes de 15 à 24 ans : 62%
- Taux brut de diplômés au primaire : 32%
- Taux d’enseignants formés : xx%
(derniers chiffres officiels datant de 1998)